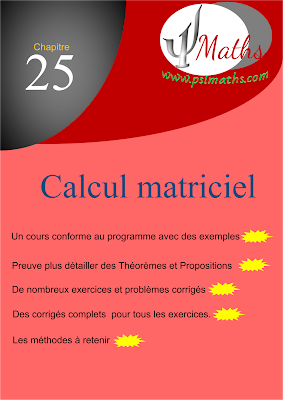Les coniques sont des courbes du plan connues depuis les grecs. Elles ont été étudiées par Menechme vers 400 ans avant
J.C, puis par Archimède, Apollonius de Perge,... Ils les voyaient comme les intersections d’un cône et d’un plan et les
avaient baptisées « sections coniques ». Suivant l’angle d’inclinaison de ce plan avec l’axe du cône, on distingue différents
cas (voir l’exercice 7.2) :
– Si cet angle est inférieur à l’angle d’ouverture du cône, on obtient une hyperbole.
– Si cet angle est supérieur à l’angle d’ouverture du cône, on obtient une ellipse.
– Si cet angle est égal à l’angle d’ouverture du cône, on obtient une parabole.
Mais d’autres situations peuvent se produire, ainsi si le plan contient le sommet du cône, l’intersection du plan et du cône
peut être formé de deux droites sécantes, ou d’une seule droite, ou même seulement de ce sommet. Ces coniques sont
dites dégénérées tandis que les trois premières obtenues sont dites propres.
Il existe d’autres façons d’introduire les coniques. Celle retenue dans ce cours est appelée « définition monofocale des
coniques », ou « définition par foyer-directrice »(voir la définition 7.1). On verra, avec la « définition bifocale »(voir la
définition 7.17) un autre moyen de définir les coniques propres.
Enfin, on peut voir les coniques comme la famille des courbes du plan d’équation cartésienne ax2 + 2bxy + cy2 + dx +
ey + f = 0 où a,b,c,d,e, f ∈ R. On apprendra dans le paragraphe 7.6 à étudier de telles courbes et comment reconnaître
parmi celles-ci les coniques propres.
Les coniques possèdent de nombreuses propriétés géométriques remarquables et on en étudiera quelques unes dans les
exercices de ce chapitre. On les retrouve en de mains endroits dans la nature. Kepler au 16e siècle a compris que que les
planètes décrivent des ellipses dont le soleil occupe un des deux foyers. Galilée au 17e siècle découvre qu’un obus tiré
d’un canon décrit une trajectoire parabolique. La trajectoire d’une comète cyclique est une ellipse et celle d’une comète
qui ne revient jamais est une parabole ou une hyperbole. Dans la vie courante, c’est grâce aux propriétés géométriques
des paraboles que peuvent fonctionner les télescopes et les antennes paraboliques (voir l’exercice 7.3)
Le plus téléchargé
facebook
twitter
pinterest
VKontakte
linkedin
google +
telegram