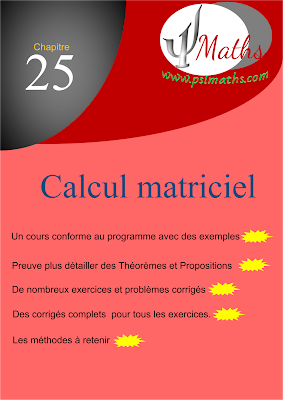Les polynômes remontent à la plus haute antiquité. Le premier usage du mot semble remonter à François Viète (1540-
1603). Cependant les babyloniens savaient résoudre les équations du second degré. Plus généralement, la résolution des
équations polynomiales a été un moteur de l’étude des polynômes. Nous avons déjà évoqué Tartaglia et Cardano éprouvant le besoin d’introduire les nombres complexes pour résoudre les équations du troisième et quatrième degré, ainsi que
Galois aux prises avec les équations du cinquième degré. Par ailleurs, le mot polynôme lui-même semble d’une origine
discutable.
Pour autant, qu’est-ce qu’un polynôme ? Prenons un exemple. Soit
f : R −→ R
x −→ f (x) = 3x₄ −2x₂ + x +1 .
On peut résumer toute l’information contenue dans f (x) à l’aide de la liste de ses coefficients :
1 ; 1 ; -2 ; 0 et 3. Un autre polynôme g(x) = x₂ − x −2 se verra attribuer -2 ; -1 et 2 comme liste des coefficients. On voit
par là que la liste est à longueur variable ce qui n’est pas confortable.
Pour que tous les polynômes soient logés à la même enseigne, on considère une suite (donc infinie) de coefficients pour
chaque polynôme en rajoutant des zéros. Autrement dit, un polynôme est assimilé à une suite de coefficients tous nuls
sauf (peut-être) un nombre fini d’entre eux.
C’est cette définition purement algébrique qui va être suivie dans ce chapitre. Faudra-t-il pour autant oublier nos bonnes
vieilles fonctions polynomiales ? Certes non ! D’abord elles sont à la base de cette nouvelle définition et elles permettent
d’établir, via le TVI, que tout polynôme réel de degré impair admet au moins une racine.
Ce chapitre a beaucoup de points communs avec le précédent. Cependant il faudra une fois de plus attendre les espaces
vectoriels pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de celui-ci
Le plus téléchargé
facebook
twitter
pinterest
VKontakte
linkedin
google +
telegram